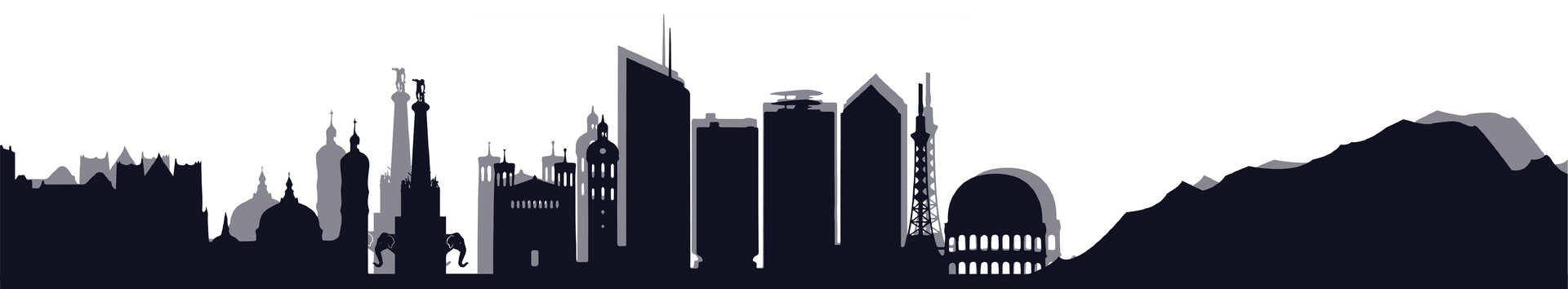Critères d’attribution des ASC : où en est-on après l’arrêt du 3 avril 2024 ?
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 a marqué un tournant décisif : l’ancienneté ne peut plus être un critère d’accès aux activités sociales et culturelles (ASC) des CSE.
Cette décision impose une refonte des pratiques, mais elle s’inscrit surtout dans une évolution plus large du droit social.
Des critères d’attribution de plus en plus encadrés
En l’absence de définition légale, la jurisprudence a défini les ASC comme les activités non obligatoires pour l’employeur, qui bénéficient prioritairement aux salariés, à leur famille et aux stagiaires, sans discrimination et sans inégalité de traitement, et qui ont pour finalité d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise.
Le code du travail prévoit un monopole de gestion des ASC par le CSE, ce dernier disposant d’un budget spécifique dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Cependant, les critères d’attribution des ASC sont de plus en plus encadrés par les juges, réduisant la marge de manœuvre des CSE.
L’arrêt du 3 avril 2024 : suppression de la condition d’ancienneté
Dans les faits, un syndicat demande en justice que soient déclarées illicites les dispositions du règlement intérieur d’un CSE instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d’accéder au bénéfice des ASC.
La Cour de cassation a jugé que les articles L 2312-78 et R 2312-35 du Code du travail ne prévoyant pas de restriction pour l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des ASC, la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de subordonner cette ouverture du droit à une condition d’ancienneté minimale.
« Il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas »
En conséquence, aucune condition d’ancienneté ne peut être imposée.
Le risque URSSAF et la mise en conformité des CSE
La non-conformité des règlements et des pratiques des CSE à cet arrêt de la Cour de cassation augmente le risque URSSAF et pourrait remettre en cause l’intégralité des prestations concernées.
Dans son Guide CSE 2025, l’URSSAF intègre la nouvelle position de la Cour de cassation mais admet que les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces prestations et faire disparaitre toute condition minimale d’ancienneté.
Il est toutefois fortement conseillé de ne pas attendre pour se mettre en conformité, en révisant les règlements de CSE car les juges ne sont pas liés par les documents administratifs de l’URSSAF.
Ainsi, les salariés privés d’ASC en raison d’un critère d’ancienneté pourraient en réclamer le bénéfice sur la base de cette jurisprudence de la Cour de cassation, et éventuellement rétroactivement à cinq années (délai de droit commun en droit civil).
Une organisation syndicale pourrait également contester l’application de ce critère.
L’impact pour les CSE et la nécessité d’une adaptation
Cette décision de justice a un coût financier direct sur les dépenses du CSE, qui doit auditer sa situation et anticiper l’augmentation des bénéficiaires.
La révision de la politique des ASC par le CSE doit être mise à l’ordre du jour, et faire l’objet d’un vote en réunion plénière sur les documents afférents à la politique ASC du CSE (ex : règlement intérieur du CSE, charte, etc.).
Les nouvelles règles applicables doivent ensuite être portées à la connaissance du personnel.
Dans le cadre de l’éventuelle redéfinition des ASC, le CSE doit en profiter pour définir précisément les bénéficiaires : une ASC est légalement une « activité bénéficiant prioritairement aux salariés, à leur famille et aux stagiaires ». Ainsi, il est conseillé de définir la « famille » (quels enfants ?), de préciser si besoin « anciens salariés » (non obligatoire), « les stagiaires ».
Vers une généralisation de l’accès aux ASC : Quels critères de modulation restent possibles ?
Les juges ont déjà écarté bon nombre de critères d’attribution et de modulation des ASC tels que :
- la nature du contrat de travail (CDD/CDI),
- la durée du travail (temps plein/temps partiel),
- la catégorie professionnelle,
- le sexe,
- l’appartenance syndicale,
- l’ancienneté,
- la durée de présence dans l’entreprise pendant l’année considérée,
- la condition de présence au 1er janvier de l’année,
En application soit du principe de non-discrimination, soit du principe d’égalité de traitement, soit d’une disposition légale.
D'après l'URSSAF, « une modulation du montant de l’avantage est envisageable selon des critères sociaux objectifs et prédéfinis », tels que le quotient familial ou le revenu fiscal de référence.
En tout état de cause, la modulation retenue ne doit jamais conduire à priver certains salariés du bénéfice de l’avantage.
Les exemples de critères suggérés par l’URSSAF sont d’apparence simple, mais ils nécessitent aussi une certaine organisation notamment la collecte des documents nécessaires (avis d’impôt sur le revenu, attestation CAF…) auprès des salariés, tout en respectant les règles relatives à la protection des données personnelles (RGPD).
Sécuriser sa pratique : le recours au rescrit social
En cas de doute sur les critères retenus, le CSE peut former un rescrit social auprès de l’URSSAF, ce qui lui permettrait de sécuriser sa pratique au regard du régime social applicable.
Cette procédure permet à tout cotisant d’interroger l’URSSAF sur l’application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale. La position prise par l’URSSAF dans ce cadre est opposable à d’éventuels redressements ou régularisations futures.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 impose donc aux CSE de revoir leurs règles d’attribution des ASC pour supprimer toute condition d’ancienneté. Une mise en conformité rapide est essentielle pour éviter les risques juridiques et financiers.
Plus largement, cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle constante visant à garantir un accès équitable aux ASC.
Ainsi, les critères d’attribution doivent être choisis avec soin : toute distinction ne reposant pas sur des éléments objectifs et justifiables est susceptible d’être sanctionnée.
Les CSE doivent privilégier des critères fondés sur la situation sociale des bénéficiaires (quotient familial, revenu fiscal de référence) plutôt que sur des éléments liés au statut professionnel ou à l’ancienneté.
Une attention particulière doit être portée à la transparence des règles d’attribution et au respect des obligations en matière de non-discrimination.
Enfin, face à l’évolution des contrôles et des attentes en matière de conformité, une veille juridique permanente et une adaptation régulière des règlements internes sont essentielles pour assurer la pérennité et l’équité des dispositifs d’ASC.